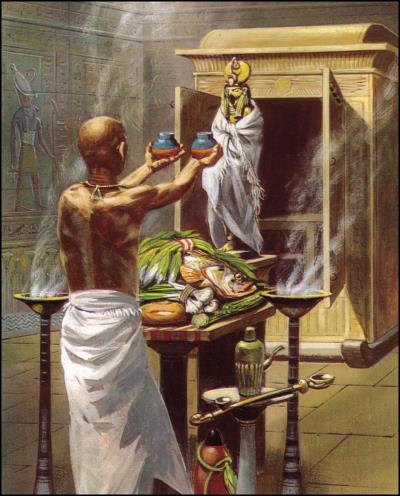Le froid et la boue dans les tranchées de 1914-1918
- L'essentiel
- Poème sur la boue
Le froid faisait de l’hiver une saison redoutée sur le front : le thermomètre descendit même à – 25 ·c à Verdun. La pluie, quant à elle, apportait surtout un ennemi redoutable : la boue, qui s’immisçait partout, recouvrait les soldats et rendait toute marche laborieuse.
a boue qui gliss’ la boue qui coule, la boue qui grimp’ la boue qui coule,
qui tomb’ d’en haut, qui r’mont’ d’en bas,
la boue à pleins bords, où qu’on rentre
jusqu’aux g’noux, souvent jusqu’au ventre…
a vous agrippe, a vous accroche…on en a jusque dans ses poches…
on en mang’ jusque sûs son pain !…
La boue ventouse, la boue vampire, qui vous engoul’, qui vous aspire…
I sembr des foès, quant’a vous prend, qu’ça s’rait ein bête, et qu’a comprend et qu’a veut, emprès vous r’vanchée, venger la Terr’ qu’a trop souffert,
la terr’, la pauv’terre des tranchées, blessée d’ partout, qu’est là couchée, les trip’ à l’air et l’ventre ouvert’ .
De la boue jusqu'à la bouche dans les tranchées
 Le froid et la pluie de l’hiver 14-15, quand rien n’était prévu pour la nouvelle forme de guerre, furent terribles.
Le froid et la pluie de l’hiver 14-15, quand rien n’était prévu pour la nouvelle forme de guerre, furent terribles.
Mais les hivers suivants, surtout celui de 16-17, avec leurs séquelles de boue et de gel, souvent entremêlées, ajoutèrent leurs souffrances à la misère quotidienne du soldat. Que dire du froid des Vosges, qui atteignait jusqu’à moins 20° dans les tranchées à flanc de coteau du Linge ou de l’Hartmannswillerkopf ? Le vin et le pain y gelaient. Gabriel Chevallier, dans la Peur, a dit la brûlure des mains à simplement toucher la plaque de couche du fusil. Mais il faut s’arrêter surtout sur la boue qui fut, à juste titre, le leitmotiv des plaintes des soldats, des notes de carnets de guerre, des récits des écrivains. Laissons la parole aux témoins.
La boue, les poilus l’appelaient de tous les noms. Mais ces noms, plus ou moins sonores, recouvraient la même marchandise. La boue, c’était la mélasse, la gadoue, la gadouille, la mouscaille.
Les boyaux ne sont plus que des cloaques où l’eau et l’urine se mélangent. La tranchée n’est plus qu’un ruban d’eau. Elle s’éboule derrière vous, quand vous avez passé, avec un glissement mou. Et nous sommes nous-mêmes métamorphosés en statues de glaise, avec de la boue jusque dans la bouche.
Un autre témoignage d'un Poilu sur la boue dans les tranchées

8 avril 1915. Ces jours-ci, une mer de boue. Des blessés légèrement atteints se sont noyés en essayant de se traîner jusqu’au poste de secours.
17 avril. Ce qui fut le plus dur de l’épreuve, ce fut la boue… Des cartouches terreuses, des fusils dont le mécanisme englué ne fonctionnait plus : les hommes pissaient dedans pour les rendre utilisables. Nous avons perdu deux fois des tranchées prises, parce qu’il était impossible d’arrêter les Boches par le feu.
Debout, les pieds aussitôt engloutis, je secoue les paquets de boue glaciale qui pèsent autour de mes deux mains. C’est la désolation. Des corvées égrenées hors des boyaux impraticables et qui tâtonnent entre les trous d’obus…
Je reprends ma marche, les pieds écartés, enjambant la terre meuble des éboulements, sondant prudemment la fange qui nivelle les trous. Et malgré tout, parfois, la boue aspire ma jambe, l’empoigne, la cramponne, la paralyse ; il me faut peiner durement pour la retirer. Du fond du trou, aussitôt rempli d’eau, mon pied ramène un enchevêtrement de fils dans lequel je reconnais tout le réseau téléphonique, agrafé d’ordinaire tout le long de la paroi, et que celle-ci a entraîné en tombant.
Vous parlez d’un fourbi !… Rien ne veut tenir là-dedans. C’est de la boue et du cadavre. Oui, du cadavre. Les vieux morts des combats d’automne, qu’on avait enterrés sommairement dans le parapet, réapparaissent par morceaux dans l’éboulement des terres.