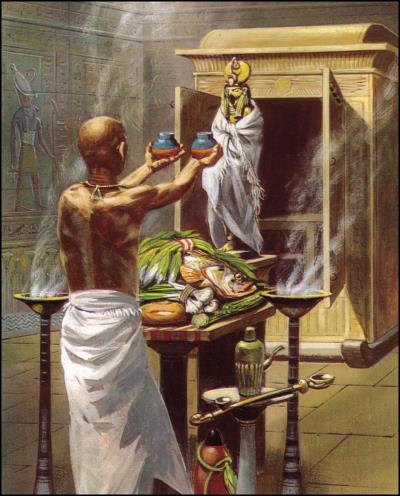Manger, l'obsession du Poilu en 1914-1918
- L'essentiel
- 1er témoignage
- 2ème témoignage
Comment, quand et où la mange-t-on, cette nourriture salie, refroidie, figée, parfois possible, souvent infecte ? En tout cas, la seule qui parvienne à ces hommes perdus. Ils ne protestent pas, ils savent que tout est misère dans les tranchées.
Ils mangent silencieusement
Ils remplissent leurs gamelles et mangent silencieusement leur ratatouille froide — bœuf bouilli, pommes de terre vinaigrées — en se penchant dessus pour la préserver de l’eau et de la terre ; mais ils ont les mains glaiseuses, et le pain qu’ils ont touché crie sous leurs dents.
Ils ne disent rien, d’abord occupés tout entiers à avaler, la bouche et le tour de la bouche graisseux comme des culasses
La proximité des morts n’empêchait pas de manger, pas plus que la saleté
La marmite (fumante) de jus circule… Chacun y trempe son quart et la moitié du bras. J’essaie d’être dans les premiers, histoire de sauvegarder l’apparence. Car on sait bien qu’en fait de propreté, tout est perdu dès que le cuisinier commence seulement à puiser l’eau. Les pommes de terre sont cuites. Je regarde le plat par curiosité. On dirait que c’est accommodé avec du cirage. Et ils sont deux ou trois à tourner cela avec des morceaux de bois. Le premier bourgeois s’enfuirait tout tremblant à voir les caporaux plongeant, avec leur quart, la moitié de leur main sale dans la marmite de soupe. Et je ne parle pas de la table (quand il y a une table) qu’on nettoie avec un balai de lieux d’aisances… Que l’on puisse garder son appétit devant ces spectacles, il le faut bien, puisque je garde le mien.
Rien n'empêche le Poilu de manger
 On essaie, quand on le peut, de faire réchauffer sa gamelle, ou son jus, sur une de ces petites lampes à alcool solidifié qui, grâce à leur simplicité, furent, parmi les inventions trompeuses des fabricants de guerre, une vraie bénédiction. Quand il faisait beau et que l’on éprouvait un peu de répit, les caporaux assis par terre, les jambes pendant dans les sapes, coupaient le fromage de leurs escouades. On a grandement de quoi boire et manger. Chacun cherchait un coin où mettre son quart d’aplomb. On ne sait où le mettre. On voyait manger de la soupe sur un journal, de la soupe froide, du pain trempé, et avec un couteau. L’officier avait la chance que son ordonnance prît soin d’une assiette d’aluminium, nettoyée au papier journal, et qu’il retournait pour ne pas manger sa confiture dans un reste de macaroni au gras. Et la proximité des morts n’empêchait pas de manger, pas plus que la saleté !
On essaie, quand on le peut, de faire réchauffer sa gamelle, ou son jus, sur une de ces petites lampes à alcool solidifié qui, grâce à leur simplicité, furent, parmi les inventions trompeuses des fabricants de guerre, une vraie bénédiction. Quand il faisait beau et que l’on éprouvait un peu de répit, les caporaux assis par terre, les jambes pendant dans les sapes, coupaient le fromage de leurs escouades. On a grandement de quoi boire et manger. Chacun cherchait un coin où mettre son quart d’aplomb. On ne sait où le mettre. On voyait manger de la soupe sur un journal, de la soupe froide, du pain trempé, et avec un couteau. L’officier avait la chance que son ordonnance prît soin d’une assiette d’aluminium, nettoyée au papier journal, et qu’il retournait pour ne pas manger sa confiture dans un reste de macaroni au gras. Et la proximité des morts n’empêchait pas de manger, pas plus que la saleté !
Des réfectoires improvisés
Les environs immédiats des réfectoires improvisés, trous d’obus, sapes abandon nées, comme ceux des cuisines, un vrai bourbier, étaient jonchés de résidus de nourriture, jetés par-dessus bord, vite transformés en montagnes d’immondice: nageant dans les eaux grasses.
La soupe des officiers dans les tranchées
 Les différences de grade pouvaient distinguer, même aux tranchées, la nourriture des compagnons de misère.
Les différences de grade pouvaient distinguer, même aux tranchées, la nourriture des compagnons de misère.
Le sergent Cazin écrit :
Nous nous sommes arrangés pour avoir une popote de sous officiers, même en campagne, c’est-à-dire à faire apprêter par des cuisiniers spéciaux les fournitures de l’ordinaire. Et le lieutenant Arnaud voit arriver dans son trou, en avant de Verdun, la soupe des officiers, en l’espèce un beau quartier de marcassin que leur cuisinier (poste de choix qui valait bien, pour le garder, d’y dépenser un trésor d’ingéniosité) avait réussi à faire mariner depuis plusieurs jours. En ce qui me concerne, à la fin de septembre 1915, sur la butte de Tahure, si Charlot, le célèbre cuisinier des officiers put préparer une imposante pile de gamelles pour une popote réduite à moi seul je n’y trouvai que de la viande froide et des pommes de terre que je dévorai indistinctement, alternant le café et le vin sans y prendre garde.
La soupe du Poilu dans les secteurs calmes

Dans les secteurs relativement calmes, la corvée de soupe comme les repas tentaient d’adopter un rythme quasi régulier . Dans ce cas, les nuance qui différencient, non seulement la dénomination mais aussi l’horaire des repas des campagnes à la ville, de la province Paris, de la famille au lycée ou à la caserne, se retrouvaient souvent aux tranchées : les hommes mangeaient la soupe les premiers, dès dix heures le matin, le sous-officiers à dix heures et demie, les officiers entre onze heures et onze heure et demie. Quant au colonel, c’était à midi et les généraux plus tard encore. Mais alors il ne s’agissait plus du front.