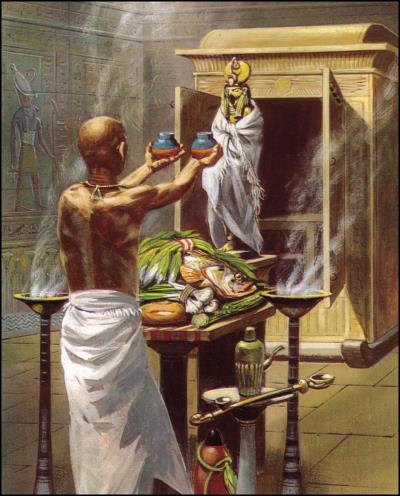Le courage du Poilu Genevoix
- L'essentiel
- A savoir !
» Mardi, 25 août, Châlons-sur-Marne. L’ordre de départ est tombé comme un coup de tonnerre » C’est par ces mots que débute Ceux de 14, le livre dans lequel Maurice Genevoix avait rassemblé tous ces écrits sur la Guerre. Admirable et terrifiant
Des tranchées à l’académie
Élu à L’Académie française en 1946, Maurice Genevoix en devient Le secrétaire perpétuel en 1958, puis Le secrétaire honoraire en 1974. IL est l’auteur de Raboliot (prix Goncourt 1925), La Dernière Harde, Beau François, La Forêt perdue, Les Bestiaires, Un jour, La Loire, Agnès et les garçons, Tendre Bestiaire… Son dernier ouvrage, 30000 jours est paru en 1980.
Les soldats de Genevoix meurent sans gloire et sans profit

Les soldats de Genevoix se font décimer, au jour le jour, par les guetteurs allemands, les obus égarés, les coups de main qui se terminent en drames.
Ils meurent sans gloire et sans profit, ignorés même du communiqué. Ils deviennent vite les sacrifiés du front. Voilà la guerre sans fin, celle qui n’a plus de raison de cesser. Genevoix y perd toutes ses illusions de sous-lieutenant fringuant. Quand il rentre de la tranchée, il n’a plus de pantalon rouge, mais une culotte de velours cuirassée de boue. Plus de képi, un passe-montagne, plus de sabre, un méchant bâton coupé dans les bois.
Il est devenu, non plus un soldat, mais un « poilu ». Les camarades tués, les enlisés, les blessés qu’on abandonne, ceux sur lesquels on marche sans le savoir, les ordres imbéciles de l’état-major commandant aux soldats de repartir à l’assaut de la butte, alors qu’ils viennent de subir le plus atroce des bombardements, de lutter trois jours et trois nuits dans la boue. Tant d’indifférence, d’inconséquences conduisent les soldats à ne plus s’émouvoir en rien des ordres et des contrordres, à ne compter que sur eux-mêmes.
Sonné par un obus de 210 tombé à ses pieds, Genevoix lui-même ne redoute plus rien. Pas la moindre indignation. Les obus ne comptent plus dans « cette espèce de farce démente ». Le sort dispose des gens.
Il est aussi absurde pour eux de mourir que de survivre.
L'ami, les camarades et les copains de Genevoix

Seuls comptent l’amitié, la chaleur des camarades, et les quelques instants de plaisir de vivre, quand on échappe à l’enfer. c’est Porchon, le collègue avec qui dort Genevoix, sur des paillasses, c’est les copains que l’on croyait morts, et que l’on retrouve au hasard des tranchées, ceux que l’on admet malgré leurs défauts, comme Durozier le pacifiste, Martin le mineur du Nord, Biloray la Fouine ou Goron le Boxeur, ces hommes venus de partout, et qui s’enfoncent dans la tourmente.
Ils dansaient chez les filles, chantaient à la messe, et puis, soudain, ils ont disparu, sans que l’on retrouve toujours leur corps. Mort, l’officier de la coloniale, bravache en gandoura qui défiait les balles, mort le légionnaire intrépide, mort le lieutenant Hirsch qui, un soir de nouba, avait embrassé sur la nuque une servante de café en lui disant « quelle importance, puisque je serai tué ! » Mort aussi Porchon, l’ami très cher, la poitrine déchirée par un obus de 77.
La familiarité de la mort cuirasse les, hommes plus sûrement que la boue. Ils n’ont que mépris pour les chefs de l’arrière, ceux qui oublient leur sacrifice, qui leur commandent des attaques impossibles, qui remettent au compte-gouttes, en grande cérémonie, avec prises d’armes et défilés, des médailles qui ne signifient rien.
La pluie, la glace et la boue

Pour le peuple du front, la pluie est une compagne familière. Les soldats, sous les trombes, fourrent leur tête dans leurs épaules, comme font des moineaux dans leurs plumes. La pluie ne tue pas, elle pénètre, et glace. La pluie est envahissante, il faut s’en garder. Se mettre à l’abri, construire des toits de branchages, des caillebotis dans la tranchée. Une nouvelle couverture livrée par l’intendance est précieuse, surtout si elle pue la naphtaline des dépôts de l’arrière, un simple imperméable devient un luxe. Il faut apprendre à marcher dans la boue, tailler des bâtons pour ne pas trébucher. Marcher en aveugle, s’agripper aux baliveaux dans les pentes.
La pluie, la glace. Savoir aussi marcher sur la glace: avancer « les jambes tout d’une pièce, des espèces d’échasses qu’on a peur de casser ». Les souliers sont précieux, plus que les bandes molletières, nids à poux.
La boue. S’en garder. Elle enduit, submerge, absorbe. On meurt dans la boue. Dans les trous, on « a la gadoue jusque sous les bras ». Ne pas s’appuyer sur le fusil. Il glisse et entraîne vers le fond. On dégage les englués, au prix de grands efforts. La boue est la pire ennemie du combattant des Éparges.
l’obscurité n’est pas une alliée. Elle emprisonne et paralyse. Le clair de lune, qui découpe les lignes, est bien meilleur. Les Allemands ne sont pas redoutables, la nuit. À vingt-cinq mètres de leurs lignes, on les entendrait presque ronfler. On les injurie au matin, quand ils se réveillent au clairon. On les reconnaît tous. Les officiers doivent gourmander leurs hommes pour éviter les fraternisations. Cela n’empêche pas de dégommer les tireurs d’élite, ceux qui tuent le copain qui se faisait couper les cheveux devant la cagna.
Les petites joies du poilu et la mort qui rôde et pue
Attendre, patienter, saisir les petites joies, creuser des pipes dans le merisier, façonner dans la glaise la tête du Kaiser. « C’est un des secrets de notre force, dit le lieutenant Genevoix à Pannechon, son ordonnance, avec de petites joies, nous savons faire du bonheur. » Se laver nu à la fontaine, rechercher les sources fraîches, acheter aux paysans des tonneaux de vin gris de Toul, négocier un cochon ou un mouton à une femme de Lorraine qui n’est restée dans sa ferme que pour s’enrichir aux dépens des soldats.
Genevoix est proche de ces gens-là. Il les aime. Tout serait acceptable, n’était la mort. Elle rôde dans les bois, frappe chaque jour, comme par mégarde. On enterre les hommes avec solennité, dans les temps de répit. Les gradés y vont de leurs discours, les copains de leurs larmes. Quand s’élève la tempête, quand s’approche le mur d’acier, on entre dans l’indicible, où Genevoix excelle. On n’a jamais décrit avec une telle minutie l’effarement, l’écrasement, l’humiliation des gens perdus dans les trous, les abîmes de glaise. Jamais rien dit de plus précis sur le glissement dans l’inconscient.
Matraqué, anéanti, le lieutenant est plusieurs fois enseveli. Chaque remontée est miraculeuse. Elle est à peine perçue comme un bienfait. Il s’étonne de respirer encore, et de voir.
La mort rôde et pue. Le champ de bataille, aux jours d’empoignade, est un charnier ignoble. II fait honte. Les chevaux tendent vers le ciel leurs pattes raidies. On ne distingue plus les cadavres mangés par la glaise, on marche dessus. Aucun effet dans la description. On passe d’une notation à l’autre, en une suite de croquis féroces.

Le saviez-vous ?
Dans la glaise des Eparges, Genevoix devient non pas un soldat mais un poilu

Le sujet qui fâche !
Des 70 hommes sous ses ordres, il n'en reste que 21.

Le détail qui tue !
On ne distingue plus les cadavres mangés par la glaise, on marche dessus